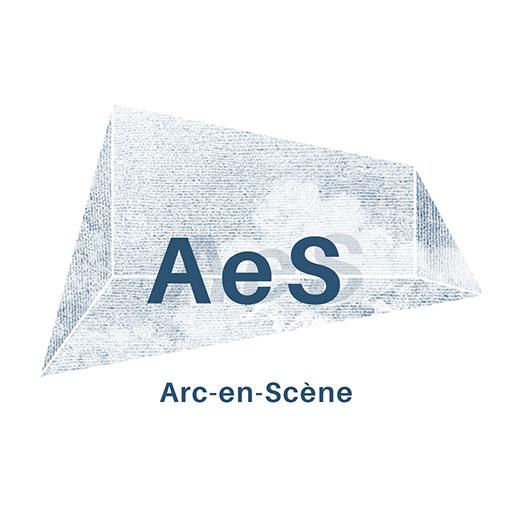La visite du site est organisée comme un parcours pluriel, à composer par les visiteurs qui sont équipés d’écouteurs au son binaural et de tablettes intégrées dans un bertelle. Les outils d’aide à la visite permettent de choisir les parcours pour leur durée ou leur thématique, ils sont le support d’autres langues pour les visiteurs étrangers et un outil de captation pour enregistrer les « souvenirs personnels du parcours ».
Chaque entité muséale, Chapelle Pointue, espace d’initiation, longère, hôpital, ruines de l’usine, maison de maîtres et ses annexes est sertie dans de merveilleux jardins thématiques qui forment la septième entité de visite.La mémoire immatérielle du domaine se fond dans la culture orale réunionnaise, transmise par les voix des histoires, par les chants et les danses. Tout au long du parcours des gardiens de la mémoire accompagnent les visiteurs pour les plonger dans le récit de vie à l’habitation. Leurs voix se déclenchent point par point, tout au long de la visite pour témoigner de l’histoire, incarner des personnages ou conter des légendes. Les points d’écoute sont identifiés par un bâton-fétiche, planté au sol, inspiré par les bâtons africains et malgaches.
L’exposition permanente : « Sur les traces de Paul Gauguin en Polynésie » s’intègre au projet de l’architecte Xavier Dogo implanté au cœur du jardin botanique de Papeari à Tahiti. Le parcours de l’exposition permanente est une invitation à rencontrer Paul Gauguin au moment de son séjour Polynésien. La rencontre de Gauguin avec la terre et la culture polynésienne a engendré la création de chefs d’œuvre picturaux mais aussi une production abondante de textes. Notre vision du parcours de visite est une entrée en voyage avec Gauguin; les visiteurs entrent dans une immersion sensorielle complète.
Les sept séquences du parcours sont sept espaces singuliers ayant chacun son identité, parfois ouverts sur le paysage, parfois refermés sur eux-mêmes en rupture pour évoquer d’autre lieux ou d’autres préoccupations. Les césures entre chaque entité donnent à voir le jardin et reconnectent les visiteurs avec la beauté du paysage polynésien. Au fur et à mesure du parcours de découverte de l’artiste, une fusion opère avec le paysage et l’âme tahitienne.
Une signalétique d’orientation informative ponctuelle et discrete. Accompagner les randonneurs tout au long de l’ascension.
Le projet de scénographie a pour objectif de mettre à disposition des randonneurs une lecture sensible du paysage : géomorphologie, biotopes, biocénose, espèces endémiques et histoires humaines à travers une approche engagée, responsable et sensible pour concilier création, écologie et bâti.
La scénographie compose avec le réel afin de construire un récit, un espace de connaissance et de réflexion pour le randonneur à travers des dispositifs de médiations simples et respectueux du site : cartographies en relief, maquettes, matériauthèques, graphisme, fresques d’orientations, cadrages informés et enfin des outils d’observation.
Les installations sont simples, modifiables et ponctuées de curiosités. Elles font sens dans leur matérialité et leurs reliefs. En effet, nous souhaitons dessiner des dispositifs simples et «hors écrans». L’architecture en harmonie avec ce site exceptionnel est un outil exemplaire de transmission pédagogique.
PAYSAGE HORIZONTAL ET VERTICAL, révéler les lignes et les mouvements.
La scénographie propose une lecture du paysage sensible, émouvante et immersive : de l’échelle microscopique au grand territoire balancé au rythme des marées et des saisons. Elle positionne le visiteur comme observateur et acteur. La ligne d’horizon, limite entre ciel et terre, est positionnée à hauteur d’oeil du visiteur et révèle ainsi les lignes mouvantes : flottaison, haute et basse mer. La scénographie est un travelling vertical et horizontal, elle explore les sous-sols, la terre, les vases et le ciel. Elle souligne l’action des marées du Golfe, ses paysages et ses activités qui animent avec les flux et reflux (flox et jusant) les motifs marins : les activités humaines dont la pêche, l’ostréiculture, la plaisance, la saliculture et les habitants (faune et flore).
Billet et tablette numérique en main, le visiteur est invité à entrer dans l’espace de l’exposition permanente pour y découvrir la richesse d’un territoire façonné par l’homme et ses activités. Un sas introductif permet au visiteur de préparer son parcours scénographique. Le compagnon de visite numérique propose une approche ludo-éducative au travers des pôles du parcours d’exposition.
La tapisserie de Bayeux témoigne d’un monde en pleine évolution.
Telle une véritable épopée, la Tapisserie de Bayeux met en scène un conflit qui va changer le cours de l’histoire européenne. Elle illustre une suite
d’évènements historiques de caractère héroïque et sublime dont le récit à la gloire du héros permet de
mêler l’histoire à la légende.
Délicatement inscrit dans son écrin architectural, le parcours se déploie de manière sensible pour accompagner les publics dans la découverte de ce trésor.
Nous leur proposons de «Plonger dans la matière – cheminer vers la lumière». La composition verticale de l’œuvre en trois registres nous a profondément inspiré, comme un écho au concept « d’art dans les marges» de Michael Camille « tous espaces de liberté artistique (sont) tolérés parce que bien
délimités et maîtrisés ». Ces marges permettent de mettre « en perspective une vision élargie du monde
créé par Dieu. Au-delà, les marges s’évident parfois pour laisser place à un élargissement de l’espace
narratif principal, tout en maintenant leur fonction d’encadrement du récit ».
Le musée de la Résistance situé à Mussy sur Seine est un musée citoyen dont le rayonnement s’étend à tout le territoire de l’Aube et au delà.
Le parcours est défini en 3 séquences :
- La séquence 1 : L’engagement
- La séquence 2 : La vie au maquis
- La séquence 3 : Les conséquences de l’engagement.
Depuis la rue, le musée est un signal par son volume, par le matériau utilisé (l’acier cortène) et constitue déjà un repère pour le public.
La notion même de Résistance résonne au présent et s’ancre dans l’actualité. La séquence 2 est la plus emblématique du musée et illustre le maquis par une atmosphère maîtrisée évoquant la clandestinité, l’action mais aussi la répression. Un campement de fortune est évoqué au cœur du maquis; la vie quotidienne est au cœur de notre préoccupation pour que cet espace permette au visiteur une immersion sensible et une compréhension éclairée de la vie au maquis.
Le bâtiment très reconnaissable de la Villa Méditerranée affirme sa nouvelle identité et sa nouvelle destination. Les façades du bâtiment
affichent le nom de « Grotte Cosquer ». Le pingouin, symbole de la grotte, est représenté sur la façade visible de la passerelle entre le fort Saint-Jean et le Mucem. La proposition de l’équipe transforme la Villa en un lieu de patrimoine, de science en action et de rencontre, vivant et populaire.
Dans le sous-sol de la Villa une véritable reproduction de la grotte Cosquer est réalisée en parcours immersif par les équipes de Kléber Rossillon. Extérieurement, la Villa Méditerranée est transformée par la création architecturale du cabinet Vezzoni : une passerelle sinueuse flottant sur l’eau, à laquelle est amarré le bateau de la découverte d’Henri Cosquer. La scénographie du centre d’interprétation est confié à Arc-en-Scène. Il est dédié au monde de la plongée et de la montée des eaux. Il se développe sur deux niveaux et met en scène les temps de la grotte, 35 000 ans avant JC, et la géographie terrestre et humaine de notre futur proche dans le monde méditerranéen
Dans l’ancien Palais épiscopal du XVIIe siècle, le musée Ingres accueille les collections des deux illustres Montalbanais, le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres et le sculpteur Antoine Bourdelle.
La rénovation du bâtiment vient offrir de meilleures conditions de présentation des collections et d’accueil du public. Les espaces du rez-de-chaussée sont dédiés à l’accueil des publics, aux expositions temporaires et à une librairie-salon de thé donnant en balcon sur le Tarn.
Une nouvelle organisation scénographique des espaces crée un parcours qui entraine les visiteurs à la découverte de Jean-Dominique Ingres et de ses élèves dans les étages supérieurs. Le premier niveau présente les jeunes années du peintre, son atelier puis une grande salle de peintures qui permet de redécouvrir ses chef-d’œuvre, et tout particulièrement « Madame Gonze» et « le songe d’Ossian ».
Les collections privées de l’artiste et la présentation de ces élèves complète l’ensemble. Au second niveau, restitué par le projet, après un temps réservé à l’histoire de la peinture, la grande salle des dessins révèle et valorise l’exceptionnelle collection de Montauban.
« L’île de La Réunion est devenue au fil du temps un territoire de la convergence, de la rencontre, de
la confrontation mais aussi de partage de cultures multiples, européennes et extra européennes ».
Notre approche du site exceptionnel de Villèle s’est cristallisée autour d’un axe révélé : l’axe est-ouest
parallèle aux longères, comme un trait d’union. Cet axe permet de re-découvrir le site dans sa pleine
richesse, en créant un nouvel équilibre. Cet axe, inscrit dans le paysage, dessine un trait d’Union entre des mondes que tout opposait.
La création d’un axe Est-Ouest parallèle aux longères associé à l’axe Nord (chapelle pointue) – sud définie par la Tour haute de la sucrerie inscrit résolument notre projet telle une « boussole » permettant la lecture éclairée du site de l’Habitation de Villèle, entre ravine et kan.En nous penchant sur la géographie des lieux, en interrogeant la toponymie de l’île (les hauts – les bas
– les plateaux), nous avons expérimenté et créé des formes de tissages par les lignes des cheminements
et les points des stations, à l’échelle du paysage, du bâti, mais aussi de l’histoire du site dans le plus
grand respect de sa mémoire.
A la demande des architectes Brochet Lajus et Pueyo, Arc-en-Scène reprend le projet scénographique en phase PRO à la suite du muséographe Christian Germanaz. Le nouveau projet Bonnat Helleu rouvre ses portes sur la rue des musées.
Le musée d’origine est complété, et renforcé dans sa géométrie conçue autour du patio central : la nouvelle salle majeure qui prend place en balcon sur cour, à la place de l‘amphithéâtre des années 50, équilibre le parcours autour du patio; rien ne change dans les usages.
Les visiteurs retrouvent le musée Bonnat d’origine, comme si rien n’avait changé, et pourtant : les mosaïques réapparaissent, le parcours dans les étages autour du patio des donateurs, s’est épaissi sur cour, les combles invisibles ont fait place à la nouvelle salle majeure du musée. Inédite, elle parait pourtant tellement accrochée à la logique du musée d’origine, qu’il semble qu’elle a toujours existé ici. Des conditions favorables sont créées pour que le dialogue s’établisse entre les œuvres et le public pour un apprentissage du regard et un accès à la signification des œuvres.