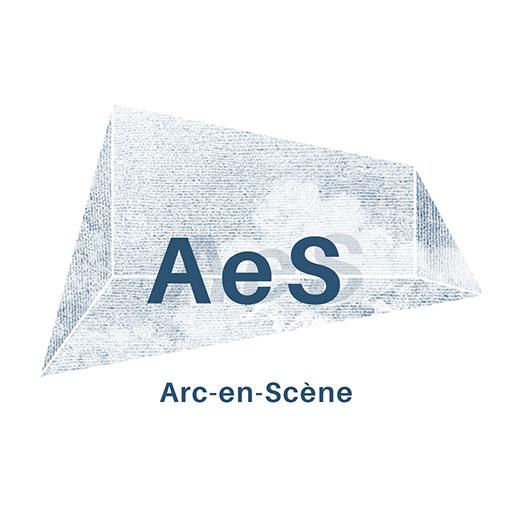Belvédère sur l’horizon du Pays Nantais et sur la lumière des reflets de la Loire ; rocher remodelé à partir de sa propre pierre extraite sur place ; dédale de terrasses polymorphes domptant l’inclinaison de la pente naturelle pour offrir des parcours multiples sans itinéraire prédéterminé ; éperon sculpté en lévitation au milieu des coteaux viticoles, dissocié des berges du fleuve et du chemin de halage par le talus ferroviaire et le passage répété des trains ; le site des Folies Siffait demeure un secret qui traduit le mystère du temps qui passe, à la fois impermanent et immuable.
Les Folies Siffait ont une triple appartenance : celle de ses auteurs, celle de la « nature » qui s’y est forgé un refuge, et celle de tous ceux qui, en parcourant le site et sans en voler l’âme, se plongent dans le très grand bonheur d’une irrépressible distraction subjective, y trouvant aussi ce qu’ils y apportent.
Notre souhait est de permettre aux publics de rentrer dans ce récit, ces témoignages, et de découvrir les usages, les histoires, qui forgent la mémoire vivante des lieux.
Le projet de scénographie au sein du bâtiment d’accueil a pour objectif d’installer le site de l’Abbaye de Sylvanès comme un point rayonnant de la région Occitanie.
Nous proposons plusieurs dispositifs cadrés sur trois échelles d’étude : régionale, locale et architecturale. Ce parcours permet à tous les acteurs de l’Abbaye de s’approprier les supports de médiation. Nous avons insisté et dessiné des dispositifs «hors écrans» : maquettes, extraits de matériaux de la région, lecture et son.Les contenus de la scénographie donnent les clefs de compréhension d’un territoire riche et complexe. Nous tentons de rendre intelligible une lecture d’un paysage façonné par les pratiques des Hommes, qu’elles soient culturelles, religieuses ou paysannes. Les dispositifs scénographiques relient les systèmes de territoires naturels et fabriqués pour mettre en relief la préservation d’une terre ressource.
Après une première appréhension du site dans le bâtiment d’accueil, les visiteurs sont invités à choisir leur expérience de parcours de visite de l’Abbaye et de ses extérieurs. Deux choix s’offrent à eux : le parcours libre, avec ou sans audioguide et le parcours en groupe, avec un animateur.
Perspective: © Antoine Dufour Architectes
Pour dessiner le projet scénographique en osmose avec le projet paysager et architectural, nous nous sommes plongés dans l’histoire du site, son patrimoine architectural remarquable, pour contribuer à entrer en résonnance avec son potentiel paysager et culturel. L’enjeu est bien de mettre en valeur « larichesse, l’identité et les spécificités du lieu ».
Le projet scénographique répond à l’enjeu de valorisation de la richesse et de l’héritage du site ; il contribue à ordonner et structurer le site « en lui donnant une identité et en améliorant sa lisibilité auprès des touristes et des dijonnais ».
La coupole s’est imposée comme le repère de l’îlot. Nous avons joué avec ses déclinaisons graphiques, les matériaux identitaires de la coupole. Nous avons opté pour une représentation de la coupole sur un matériau noble, un trait gravé sur une plaque de métal doré.
L’héritage des siècles passés sur cet îlot en fait véritablement ce lieu unique à Dijon que nous souhaitons profondément mettre en valeur tout en l’inscrivant dans le mouvement de la vie contemporaine.
LE GRAND SPECTACLE.
D’« une tour pour regarder les montagnes» d’Auguste Perret à l’observatoire d’un monde en mutation.
Le parcours de visite : la tour Perret, miroir pérenne des mutations de la ville : La tour Perret, signal
toujours présent pour la ville, initialement pensé comme un observatoire « sur les montagnes »,
est devenu, par la force du temps, un belvédère sur les transformations de la ville et du parc, d’un
paysage en perpétuelle évolution. Elle est le témoin privilégié de la rencontre entre des massifs
apparemment immuables et une ville qui ne cesse de se métamorphoser. Le parti pris scénographique : une approche orographique. Nous avons souhaité intégrer les fragments du grand paysage dans une approche ludique et narrative, jouer avec les formes, avec les échelles dans l’espace et dans le temps, pour s’approprier les lieux, le paysage, découvrir et mélanger les usages. Comme les pièces d’un puzzle, chaque station, comme une sculpture habitable, dessine un fragment d’un récit comme des chapitres thématiques d’une histoire qui s’inscrit lui aussi dans le temps et dans l’espace.
Nous souhaitons donner à lire les parcours qui irriguent des lieux :
les parcours du quotidien, des loisirs, les parcs, des arts, des commerces, les parcours sportifs, culturels, patrimoniaux, de chalandise, de biodiversité, etc. Les parcours seront matérialisés par des jalons : sur le sol, comme des rubans, de longues bandes graphiques donnent de la souplesse à la lecture du sol.
Les jalons pourront prendre la forme également de mobiliers spécifiques, ils pourront être exprimés par un mât scénique (structure tubulaire tridimensionnelle) à la fois support d’éclairage, d’équipement audiovisuels et de signalétique. Nous avons à cœur de travailler un vocabulaire simple, voire minimaliste, à partir d’une ligne, horizontale, verticale, pliée…
En partant DU SOL – DE L’HORIZON – DU CIEL, nous dessinons une structure narrative. Les jalons et les salons urbains permettent de révéler les parcours de curiosités, les repères identitaires, et portent une attention particulière aux « lieux singuliers » de la place appartenant à la ville.
La maison de site de la forêt de Saoû prend place dans l’ancienne Auberge des Dauphins. Ce lieu va vivre plusieurs mutations : une mutation d’usage, en devenant un espace d’introduction à la forêt, ainsi qu’une mutation des regards sur l’auberge, elle devient une porte d’entrée du site pour une découverte ce nombreux sujets tant sur la nature que sur les patrimoines. La forêt est le sujet majeur.
Le parti scénographique propose de faire découvrir aux visiteurs la ligne de crête du synclinal de Saoû. En franchissant l’entrée dans la première partie d’exposition, ils découvrent une grande paroi silhouette qui se déplie et organise les différentes thématiques. Ce « paravent du savoir » est une strate verticale de matériaux translucides. Elle permet de comprendre la silhouette du massif et d’orienter les visiteurs sur la toponymie de ce massif exceptionnel.
Notre approche est avant tout poétique pour rendre visible et lisible la ville, pour donner à voir l’épaisseur de Ris Orangis avec la Seine, retisser avec la ville, reconnecter au Rû, rendre visible et lisible les tracés historiques et les tracés actuels, souligner « ses lignes d’horizon dans l’espace et dans le temps ».
RIS ORANGIS, récits imaginaires – est un parcours de curiosités avec pour mission la création d’un parcours d’interprétation du patrimoine. Par le temps passé sur site, notre première approche scénographique a été de développer une approche quasi cartographique afin d’identifier les imaginaires, les récits,
l’Histoire, les tracés…pour en quelque sorte exhumer le génie des lieux.
Images perspectives : Mutabilis
Le centre d’éducation à l’environnement se développe en deux grandes entités : le Centre et la Maison Guerlain.
Le Centre est consacré à l’approfondissement et à la compréhension du réseau d’interdépendance permettant le maintien et le développement de la vie mais aussi les notions de diversité, de territoire du Lac de Grand-Lieu. La scénographie se développe autour d’un nid et d’un herbier flottant. Une structure en bois trame les sous espaces et les différentes séquences de visite.
Enfin, séquence clé de la visite, poétique et onirique, les visiteurs s’approchent du lac grâce à la Maison, comme si elle incarnait le lieu de la rencontre du sauvage et du domestique se découvrant au fil des pièces dans son identité doublement magique, étrange et fascinante.
Le Pôle est un lieu de connaissance et de découverte des vins du Pays de Lunel sur la commune de Saint Christol. L’implantation du Pôle se situe sur un ancien terrain appelé « la Glacière ».
Les axes majeurs du projet sont : la découverte du terroir et du vin, la valorisation du vin et de la vigne, déguster, apprendre, différencier.
Les espaces d’exposition et d’animation sont destinés à sensibiliser les publics aux mondes viticoles et vinicoles, aux traditions camarguaises.
Les espaces extérieurs, jardin ampélographique, théâtre de verdure, abords, stationnement… sont d’avantage consacrés aux activités récréatives ; les enfants ont une place centrale dans le projet.
Les mobiliers intérieurs et extérieurs dialoguent avec le vocabulaire architectural en cohérence et en harmonie avec le paysage.
Le site archéologique de Chassenon/Cassinomagus révèle la présence des ruines des plus grands thermes gallo-romains du territoire français.
La scénographie du parcours de visite, invite les visiteurs à une découverte du site depuis la passerelle suspendue : cette perception en vol d’oiseau permet de comprendre le génie de cette construction.
En rejoignant le niveau des thermes dit des « curistes », les visiteurs s’immergent dans des mises en scènes intégrées aux vestiges, donnant à voir, à entendre et à comprendre, de manière immersive, la vie gallo-romaine des premiers siècles de notre ère.
La scénographie met en œuvre des matériaux pérennes (acier laqué et porcelaine émaillée) qui peuvent résister à une exposition en plein air.